Pierre de BRETIZEL : Les eaux souterraines du Mont Agel ...
|
|
|
|
Pierre de BRETIZEL : Les eaux souterraines du Mont Agel ... |
|
![]()
D'après l'inventaire descriptif, présenté ci-dessus, des diverses déformations et leur report sur la carte ci-jointe, on peut en déduire leur chronologie relative.
|
4.1. Phase précoce II apparaît que des reliefs érodés d'un ancien chaînon plissé de style jurassien aient servi de substratum sur lequel se sont déversés les grands chevauchements ayant « construit » le massif du Mont Agel. Ces paléoreliefs témoignent d'une phase orogénique antérieure à celle des chevauchements. La zone anticlinale du Seuillet - Malpas - Cap Martin est l'unité tectonique la plus évidente de l'existence de cette phase précoce. Il convient cependant de se replacer dans le contexte d'ensemble de l'arc de
Nice |
Vu d'ensemble, l'Arc de Nice, de la crête frontière à l'est jusqu'à la plaine du Var à l'ouest, dessine une série d'axes anticlinaux subméridiens, mais déformés et disloqués par des mouvements tectoniques plus récents. Leur direction générale indique une compression d'est en ouest.
Dans le secteur du Mont Agel, l'anticlinal ancien du Seuillet-Malpas est la structure la plus évidente pouvant appartenir à la phase précoce ci-dessus. Sa liaison avec d'autres structures éventuelles situées plus au nord-ouest est coupée net par la grande faille tardive de
Peille - Sainte Thècle. Si on revient à une topographie antérieure au rejet de cette dernière, on peut admettre par hypothèse une continuité d'origine entre l'anticlinal du Seuillet et celui du Mont Férion, l'ensemble dessinant alors un tracé sigmoïde classique dans ce style de tectonique (cf. figure 1).
L'avancée de l'est vers l'ouest de dépôts marins éocènes dans le bassin de Contes paraît avoir été arrêtée à l'ouest par le paléorelief disloqué du Mont Férion, comme en témoignent les litofaciès littoraux de la base de ces dépôts et leur position discordante sur le substratum crétacé (en cours d'étude par notre association).
Vers le sud, la transgression marine éocène ne paraît pas avoir dépassé la
ligne actuelle du Paillon, d'où notre hypothèse d'un paléorelief formant « pont » entre l'axe du Seuillet et celui du Férion. L'ensemble préfigure assez bien le dessin actuel de l'Arc de Nice.
D'après les faunes présentes dans les bancs de base de l'Eocène, on peut caler chronologiquement cette phase
orogénique au Lutétien (phase pyrénéenne).
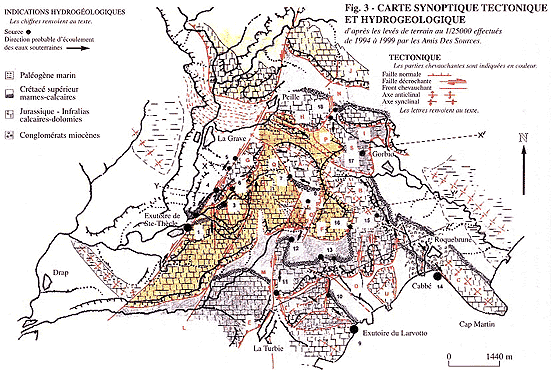 Cliquer sur la carte pour l'agrandir Accès aux coupes tectoniques |
4.2. Phase intermédiaire Au sud de la vallée du Paillon, une succession de trois chevauchements, de direction sud-ouest nord-est et à déversement vers le sud (unités E, F, G décrites ci-dessus), vient recouvrir partiellement les paléoreliefs de la phase précédente. Le secteur du Mont Agel se situe dans la partie orientale de ce groupe de déformations. |
D'après B. GEZE (1966), ces chevauchements formeraient le front d'un vaste décollement régional d'assises de couverture ayant glissé vers le sud sur des couches gypseuses et marneuses « plastiques » du Keuper, reposant elles-mêmes sur un socle permien rigide. Ce décollement régional aurait été la conséquence du « soulèvement » du massif du Mercantour.
Cette explication ne nous paraît guère convaincante car les amas gypseux du Keuper sont discontinus, passant latéralement à des dolomies et des marnes : dans l'Arc de Nice même, les faciès gypseux ne sont vraiment identifiés que sur ses bordures, à Saint Blaise, à Sospel et à Cimiez. Ailleurs le Keuper marneux apparaît peu représenté au sud du Mercantour où le muschelkalk est souvent en contact direct avec l'Infralias. S'agit-il d'un « rabotage » basal comme on le pense communément ?
Ou bien n'est-ce pas plutôt une lacune sédimentaire ?
Si les décollements de la série de couverture sur le Trias sont bien réels et observables à proximité de la limite sud du Mercantour et du dôme de Barrot, les corréler avec les chevauchements de l'Arc de Nice entre le Paillon et la mer, 30 kilomètres plus au sud, nous paraît une hypothèse hasardeuse.
Par contre, on peut constater que les masses calcaires jurassiques chevauchantes y reposent toujours sur les bancs marneux plus ou moins décollés et plissotés du Crétacé supérieur.
De ce fait, nous pensons que les ruptures en front de chevauchement sont le fait d'une différence de compétence entre le Jurassique à dominante calcaire rigide et le Crétacé supérieur à dominante marneuse ductile, l'ensemble étant soumis à une compression dans le plan horizontal, dirigée nord-sud.
Cette compression se serait appliquée sur un faisceau de trois anticlinaux préformés au cours de la phase de compression précédente, dans la zone intermédiaire entre le Férion et le Seuillet
(cf schéma chrono-tectonique, en haut de page).
Les lignes de rupture, à partir desquelles les calcaires jurassiques seraient
montés puis auraient glissé sur les marnes crétacées, ont pu s'ouvrir à partir de failles d'extension longitudinales ayant provoqué l'affaissement des flancs sud des anticlinaux. (De telles structures d'extension sont connues ailleurs, notamment dans le Jura, où elles affectent souvent les plissements isoclinaux après leur mise en place.)
Lorsqu'intervient une nouvelle phase de compression, celle-ci a tendance à propulser le compartiment haut sur le compartiment affaissé (faille inverse devenant par excès chevauchement). On a alors ce qui est reconnu sous le nom de chevauchement épiglyptique.
Les forts pendages (60° vers le nord) observés au-dessus de la vallée du Paillon le long des
crêtes de la Caussinière et du Rastel et entre Saint Pancrace et Peille indiquent très probablement les plans d'enracinement des chevauchements sur les failles inverses initiales. Ces forts pendages, formant rampe, contrastent bien avec la position sub-horizontale des chevauchements du Rastel (G) et du Mont Agel (F) qui indiquent un déplacement vers le sud de 0,5 km pour le premier et de 4 kilomètres pour le second. L'enracinement du chevauchement de la Turbie (E) est masqué presque partout par l'avancement du chevauchement du Mont Agel, sauf sur le flanc est, au-dessus de Gorbio, où les décrochement latéraux indiqueraient un déplacement de 2 kilomètres vers le sud.
Ces transferts vers le sud ont été créateurs de reliefs importants, particulièrement à l'est où la masse chevauchante du Mont Agel est venue coiffer le relief pré-existant du Seuillet-Malpas.
Les déséquilibres gravitaires qui en ont résulté ont créé des ruptures distensives à l'ouest comme à l'est de l'axe du Seuillet-Malpas : ces ruptures sont les failles normales à regard ouest du faisceau des Cabanelles (O) et du faisceau de Saint Pancrace (Q) ainsi que le graben du Mont Galian (P).
Les falaises formées par le front chevauchant de la Turbie (E) ont commencé à être démantelées par l'érosion littorale de la mer au Miocène, comme en témoigne l'épaisse formation conglomératique de Roquebrune.
Ces dépôts miocènes résultant du démantèlement de reliefs jeunes permettraient de corréler cette phase intermédiaire de compression dans l'Arc de Nice avec la phase majeure de plissement de l'Arc de Castellane.
4.3. Phase tardive et actuelle
Après une période de distension et d'érosion des reliefs formés au cours de la phase miocène, une nouvelle phase de compression due à une poussée d'est en ouest recoupe les structures antérieures de l'Arc de Nice et en rajeunit les reliefs.
Un important bourrelet de fronts chevauchants vient fermer l'Arc au nord-est. La cime du Baudon en forme l'extrémité sud.
| Une longue ligne de rupture et de coulissement apparaît sur la limite nord-ouest du massif du Mont Agel : c'est la faille de Peille-Sainte Thècle (K) et son satellite la faille de Laghet (L). Le bassin synclinal du Paillon va se trouver déporté vers le sud-ouest et abaissé par rapport au massif du Mont Agel. Sous l'effet de la même poussée, celui-ci se soulè ve en même temps que se creuse au sud la fosse Ligure. II en résulte une dislocation du front chevauchant de la Turbie (E) entraînant vers le littoral des paquets de calcaires jurassiques, glissant sur les terrains marneux crétacés. Ainsi, à la Pointe de la Veille, au pied de la corniche de Vistaero (R),1a masse calcaire jurassique glissée se retrouve « posée » à la fois sur le Crétacé et sur les poudingues miocènes. |
|
Tous ces mouvements apparaissent synchrones avec le bouleversement généralisé du Bassin Méditerranéen daté en Messinien (Pontien), à la limite Miocène-Pliocène.
I1 est possible que cette phase de compression ait pu se poursuivre jusqu'au quaternaire.
Au cours de la période historique, de forts séismes et d'importants mouvements de terrain gravitaires (éboulements, glissements, effondrements) sont signalés. Ils témoignent de l'existence d'une période de distension des parties profondes et d'érosion rapide des reliefs qui se poursuit à l'heure actuelle, en même temps qu'un enfoncement généralisé de la zone côtière entre la Provence et le Golfe de Gênes.
On peut résumer la succession de ces déformations dans le tableau synoptique ci-après
:
| Périodes | Phases | Types de structure | Unités de la carte |
| Lutétien 45-50 M.a. |
Compression est-ouest
Distension |
Plis isoclinaux
Affaissements axiaux |
A |
| Miocène inférieur et moyen 15-20 M.a. |
Compression nord-sud
Distension |
Chevauchements épiglyptiques
Failles normales |
E F G H D P Q |
| Messinien 5 M.a | Compression nord-est sud-ouest |
Chevauchements
|
I J K |
| Pliocène Quaternaire Actuel | Distension | Effondrements gravitaires | R S T U |
|
|
|
|